Composition d'une cellule
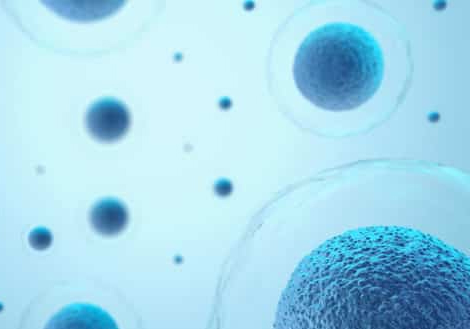
La membrane plasmique
La membrane plasmique, également appelée membrane cellulaire, entoure l'ensemble du contenu de la cellule. Elle se compose d'une double couche de phospholipides dans laquelle s'insèrent des protéines, des glucides et du cholestérol. Cette organisation forme une structure souple et semi-perméable, assurant un contrôle précis des échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extérieur. Chez les cellules animales, elle délimite l'espace cellulaire, tandis que chez les cellules végétales, elle se trouve juste sous la paroi cellulaire rigide composée de cellulose.
Les protéines membranaires remplissent diverses fonctions, allant du transport actif d'ions au rôle de récepteurs pour des signaux chimiques. Par exemple, les aquaporines facilitent le passage de l’eau, tandis que les protéines de type ATPase régulent le flux d’ions sodium ou potassium, maintenant ainsi le potentiel membranaire indispensable aux neurones et aux cellules musculaires.
Le cytoplasme
Le cytoplasme constitue l’espace interne de la cellule, situé entre la membrane plasmique et le noyau. Il contient le cytosol, un gel aqueux riche en ions, protéines, acides aminés et autres petites molécules. Ce milieu accueille les organites cellulaires et les réseaux du cytosquelette. Des réactions métaboliques y ont lieu en permanence, comme la glycolyse, première étape de la dégradation du glucose.
Le noyau
Le noyau est présent dans toutes les cellules eucaryotes. Il est entouré d'une enveloppe nucléaire à double membrane percée de pores nucléaires, permettant les échanges de macromolécules entre le noyau et le cytoplasme. Le noyau abrite l’ADN sous forme de chromatine, qui contient l’ensemble des gènes nécessaires à la synthèse des protéines. Lors de la division cellulaire, cette chromatine se condense en chromosomes visibles au microscope optique.
Un nucléole, visible à l'intérieur du noyau, synthétise les ARN ribosomiques et assemble les sous-unités des ribosomes. Par exemple, dans une cellule pancréatique produisant des enzymes digestives, le nucléole est particulièrement développé afin de soutenir une production élevée de protéines.
Les ribosomes
Les ribosomes sont les organites responsables de la traduction de l’ARN messager en protéines. Ils peuvent être libres dans le cytoplasme ou associés au réticulum endoplasmique rugueux. Leur structure se compose de deux sous-unités, une grande et une petite, contenant des ARN ribosomiques et des protéines. Chez les cellules musculaires, des ribosomes libres synthétisent les enzymes nécessaires à la contraction, tandis que dans les cellules sécrétrices, ceux associés au réticulum produisent des protéines exportées, comme l’insuline dans les cellules β du pancréas.
Le réticulum endoplasmique
Le réticulum endoplasmique (RE) se divise en deux formes : rugueux et lisse. Le RE rugueux est recouvert de ribosomes et intervient dans la synthèse et la modification initiale des protéines. Le RE lisse participe à la synthèse des lipides, à la détoxification de certaines substances et au stockage du calcium. Dans les cellules hépatiques, il joue un rôle dans la neutralisation des toxines, tandis que dans les cellules des glandes surrénales, il intervient dans la synthèse des stéroïdes.
L’appareil de Golgi
L'appareil de Golgi prend la forme d’un empilement de saccules aplatis. Il finalise la maturation des protéines issues du RE, les modifie par glycosylation, les trie et les dirige vers leur destination finale : la membrane plasmique, les lysosomes ou l’extérieur de la cellule. Dans les cellules intestinales, il prépare les enzymes digestives avant leur sécrétion dans la lumière intestinale.
Les mitochondries
Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. Elles transforment les nutriments en ATP grâce à la respiration cellulaire. Ces organites possèdent une double membrane, dont la membrane interne est repliée en crêtes, augmentant la surface disponible pour les réactions biochimiques. Leurs propres ADN et ribosomes leur permettent de produire certaines protéines de manière autonome. Dans les cellules musculaires, leur nombre est élevé pour répondre à une forte demande énergétique, comme dans les fibres rouges spécialisées dans l'endurance.
Les lysosomes et peroxysomes
Les lysosomes sont des vésicules remplies d’enzymes hydrolytiques servant à digérer les déchets intracellulaires, les organites endommagés ou les particules absorbées par endocytose. Par exemple, dans les macrophages, ils participent à la destruction des agents pathogènes. Les peroxysomes, eux, dégradent les acides gras à très longue chaîne et neutralisent le peroxyde d’hydrogène, un sous-produit toxique du métabolisme cellulaire.
Le cytosquelette
Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques qui assure la forme de la cellule, le transport intracellulaire, la division cellulaire et les mouvements. Il comprend les microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments d’actine. Les microtubules servent notamment de rails pour le transport des vésicules. Dans les neurones, les protéines motrices comme la kinésine déplacent les neurotransmetteurs le long des axones vers les synapses.
Les structures spécifiques
Selon leur spécialisation, certaines cellules possèdent des structures additionnelles. Les cellules végétales disposent de vacuoles remplies de sève cellulaire, de chloroplastes responsables de la photosynthèse, et d’une paroi cellulaire rigide. Chez les spermatozoïdes, le flagelle confère une motilité indispensable à la fécondation. Les cellules ciliées de la trachée présentent des cils vibratiles pour évacuer le mucus contenant les poussières ou micro-organismes inhalés.
La diversité et la spécialisation des structures cellulaires expliquent la grande variété des fonctions dans l’organisme. Chaque constituant joue un rôle précis, permettant à l'ensemble de la cellule de fonctionner de manière coordonnée dans un environnement complexe.